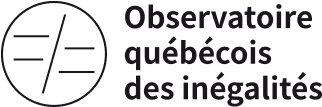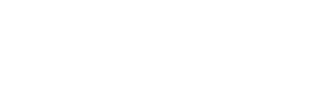Thème: Culture et société
Publié le 25 novembre 2025
Le 29 octobre dernier, l’Observatoire a eu le plaisir de convier ses membres à assister à un échange entre Mark Fortier et Maïka Sondarjee sur la thématique des inégalités sociales et de la montée de l’extrême-droite.
Mark Fortier est sociologue, éditeur chez Lux et auteur d’un essai paru cette année Devenir Fasciste. Ma thérapie de conversion. Maïka Sondarjee est professeure à l’Université d’Ottawa, autrice de plusieurs livres dont le récent Tu viens d’où ? : Réflexions sur le métissage et les frontières.
La directrice de l’Observatoire, Nathalie Guay, a animé cette table ronde. D’entrée de jeu, elle a expliqué que ce thème s’est imposé en raison d’un contexte international caractérisé par la montée de l’extrême droite et des inégalités, et par le recul de l’État social : le Québec est-il à l’abri de ces dynamiques et, si non, que faire?
À quoi reconnaît-on l’extrême-droite?
Les panélistes ont souligné que l’extrême droite apparaît sous une pluralité de visages et qu’elle est désignée par un éventail d’étiquettes, qu’il s’agisse d’autoritarisme, de populisme, d’illibéralisme, de néofascisme ou encore de droite radicale.
Maïka Sondarjee estime qu’il faut toutefois éviter de s’enliser dans des débats sémantiques et rappelle les thèses d’Umberto Eco dans son pamphlet Reconnaître le fascisme où il explique que le fascisme est moins une idéologie cohérente qu’une diversité de traits, de symptômes et de réflexes. Mark Fortier évoque aussi, pour sa part, la « flexibilité idéologique » de l’extrême droite et cite Robert Paxton qui avance dans L’Anatomie du fascisme, que l’on reconnaît surtout le fascisme par ses actions. En ce sens, Maïka Sondarjee rappelle qu’il importe de distinguer la présence et la diffusion d’idées d’extrême droite dans une société et l’instauration d’un régime qui s’en réclame. À cet égard, la « conversion fasciste » est quelque chose qui se produit lentement et non tout d’un coup.
Les membres du panel ont attiré l’attention sur plusieurs marqueurs idéologiques dont la somme permet de reconnaître l’extrême droite :
- La promotion d’une conception autoritaire de l’État.
- Un nationalisme conservateur centré sur l’identité ethnoculturelle majoritaire.
- Un discours dont le ton est marqué par le mépris et la haine, qui contraste avec le niveau habituellement plus serein du débat public dans les démocraties, même en situation de désaccords.
- Une rhétorique fortement teintée de paranoïa, désignant à la fois des « ennemis de l’intérieur » et les personnes immigrantes.
Comment l’extrême droite se positionne-t-elle vis-à-vis des inégalités?
Selon Mark Fortier, l’extrême droite s’appuie sur une conception inégalitaire de la société, qu’elle estime fondée sur une hiérarchie naturelle. Dans cette perspective, elle ne s’intéresse pas aux débats sur les modalités d’accumulation de la richesse ou sur la redistribution des pouvoirs, ce qui peut la fragiliser à terme face à des revendications sociales.
Qu’est-ce qui explique les succès des idées de l’extrême droite et la faiblesse d’une alternative politique?
Les succès de l’extrême droite résident dans sa capacité à canaliser la colère en désignant des ennemis, estiment les panélistes, et la circulation de ses idées bénéficie du soutien actif de certaines grandes entreprises médiatiques. Aux États-Unis, c’est Fox News notamment, mais aussi des géants du numérique et des médias sociaux, puis des milliardaires qui, avec leurs leviers, tirent la société vers l’extrême droite.
La poussée de ces idées résulte aussi de la faiblesse d’une alternative progressiste. La gauche, au Québec comme ailleurs, peine à transformer la colère populaire en projet politique. En outre, à gauche, soutient Mark Fortier, il y a présentement une tension entre la défense de l’égalité et de sa charge sociale et la valorisation de la diversité qui est agitée comme un épouvantail par l’extrême droite. Face à ce constat, Maïka Sondarjee considère qu’il est essentiel qu’une lutte n’en invisibilise pas une autre : les deux doivent être menées de front, précisément dans une perspective d’égalité.
Doit-on craindre la montée de l’extrême droite au Québec?
Nos panélistes se sont accordés sur ce point : aucune société n’est immunisée contre la montée de la droite radicale. Si les États-Unis peuvent être séduits par de telles idées, rien ne permet de présumer que la société québécoise en serait immunisée.
Au Québec, certains discours sur l’immigration posent problème et de nombreuses attaques trempées dans le ressentiment sont proférées sans fondement. La qualité et la civilité du débat public paraissent s’éroder. Nos panélistes estiment qu’il faut également s’inquiéter de l’affaiblissement des contre-pouvoirs.
Comment se prémunir de la montée de l’extrême-droite au Québec?
Pour freiner l’extrême droite, les panélistes invoquent quatre stratégies.
Une première, c’est l’importance de renforcer la solidarité sociale. La « néolibéralisation du rapport à l’autre » affaiblit la solidarité, soutient Maïka Sondarjee. L’extrême droite se nourrit de la peur qu’elle-même suscite et exploite la solitude, terrain propice aux pulsions autoritaires. Aussi, « toutes les formes de solidarité sont des freins à l’extrême droite », dira Mark Fortier.
Une deuxième stratégie, c’est la nécessité de développer un projet concret à gauche. Il faut parler des inégalités, elles sont le talon d’Achille de l’extrême droite qui n’a pas de politique sociale. Les forces progressistes doivent définir un projet clair, afin que l’on comprenne les enjeux pour lesquels on se mobilise, et le présenter de manière accessible, sans intellectualisme.
Une troisième stratégie vise à combattre l’effritement du rapport à l’autre, à retrouver la capacité de dialoguer. Nos panélistes parlent de « générosité épistémique », à savoir une posture qui consiste à accueillir avec bienveillance et à considérer sérieusement les arguments d’autrui, même si leurs opinions sont différentes des nôtres. Il faut « prendre le temps de s’écouter ». Heureusement, au Québec, grâce au sens communautaire qui perdure malgré tout, il existe encore un espace où nous sommes encore capables de nous parler. Il faut investir davantage cet espace.
Une quatrième stratégie proposée par nos panélistes, complémentaire à la précédente, c’est de sortir de nos chambres d’écho, de l’entre-nous. À gauche, on boude certains lieux, alors qu’il faut parler au plus de monde possible, ce qui implique aussi d’investir les réseaux sociaux en dépit des critiques et controverses qu’ils peuvent générer.